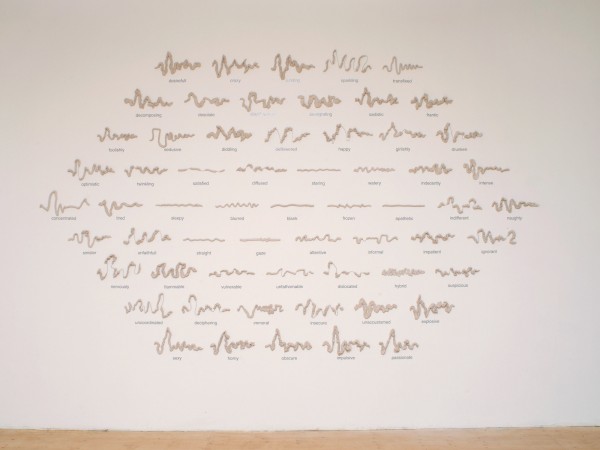«Par architecture, je n’entends pas seulement l’image visible de la ville et l’ensemble de ses architectures. Il s’agit plutôt ici de l’architecture comme construction; je veux parler de la construction de la ville dans le temps.»1
L’œuvre Déjà fait d’Alfonso Arzapalo propose, par une image synchronique (une image constituée d’événements simultanés), de faire l’expérience d’une œuvre déjà-là mais toujours en transformation. Dans ce travail, la réalité d’un lieu photographié et la photographie de ce même lieu sont présentées au même moment, sur différents plans du site de la prise de vue. L’artiste a élaboré un parcours dans la ville ponctué par des fragments photographiques. Ainsi, des photographies agissent simultanément dans des endroits spécifiques de la ville. Arzapalo accorde une attention particulière à l’architecture dans son œuvre, ce qui accentue la relation entre la mémoire individuelle de notre expérience et la mémoire collective des monuments laissés par l’histoire.
Parcourir la trace
Dans le parcours que nous propose Arzapalo, je me suis d’abord rendu au parc des Champs-de-Bataille près de la Citadelle de Québec.
Arrivé à cet endroit, je remarque un objet qui se tient dans le paysage, un rectangle sur une tige métallique. Je m’en approche et je vois sur une de ses faces les maisons situées dans la rue Saint-Denis, derrière l’objet. Étrange impression de similarité et de différence entre les plans. Légères nuances entre les luminosités. Je me déplace autour de la photo. Suivant la série d’habitations, le point de vue s’ouvre sur l’étendue du fleuve Saint-Laurent et la rive sud, puis sur la Citadelle qui donne par la suite sur une vue en plongée de la ville, et finalement, retour aux habitations et à la photo placée en face de moi. Je la regarde à nouveau, un homme et une femme passent, puis je me rends à la prochaine halte.
Cet endroit offre un point de vue stratégique sur le fleuve et les environs, d’où la présence de la Citadelle construite deux siècles auparavant sur les hauteurs du cap aux Diamants pour servir à la défense de la ville. À cet endroit, Arzapalo a photographié une série de demeures néo-classiques sises rue Saint-Denis. La photographie plantée dans le gazon installe une relation directe avec le sujet photographié. Ainsi, le fragment photographique s’ouvre à son environnement dans un parallélisme entre les temporalités. Le présent coexiste avec le passé, le fragment avec la totalité, et l’instant avec la durée de l’expérience du parcours dans le tissu urbain.
L’artiste nous confronte à une photographie conceptuelle qui oscille entre la photo du site, le site lui-même et le trajet qui relie les différents points. Il propose une expérience qui prend place entre le photographique, le «performatif», l’architectural, alors qu’il se sert de la photographie comme lieu temporel pour mettre l’accent sur des fragments d’architecture dans un parcours à l’intérieur de la cité. L’œuvre existe déjà. Arzapalo marque des places et propose des haltes. Son parcours devient nôtre. Chacun des fragments photographiques fait face à la totalité qui a été photographiée et renvoie au déplacement qui les contient. Son attention accrue à l’espace urbain nous est transférée et nous entraîne à imaginer le lieu que nous habitons.
La spécificité du site et la disposition spatiale de chaque photographie influencent notre relation avec celle-ci en tant qu’objet. La photo dans le parc des Champs-de-Bataille engendre une relation circulaire et la tige d’acier agit comme un pivot dans le paysage alors que la photographie disposée à la place d’Youville installe un rapport frontal par une accumulation de couches successives. Chez Alfonso Arzapalo, l’image se construit dans la relation entre la photographie, le lieu photographié, le parcours, cela pour donner à vivre une expérience différente de la photographie. Ainsi, ses photographies idéelles et son attention accrue au tissu urbain engendrent une intensification du quotidien. Par le trajet, il insère en l’instant photographique une durée dans laquelle l’image se transforme. Il travaille avec l’idée de paysage alors que s’effectue un déportement d’une place vers une autre dans le parcours proposé. Le souvenir du lieu visité dure et persiste dans le suivant. Le paysage se fixe dans la photographie mais se transforme continuellement dans le réel et dans la mémoire. De cette manière, la marque qu’est le paysage agit comme l’effacement du support et procure un dépaysement. Temps, mouvement, durée… Voir l’intervention urbaine réalisée par les habitants comme élément constitutif de l’œuvre. Penser le document de l’action éphémère car ce qui reste est dans le document et dans la mémoire comme une intention de briser les limites entre le milieu artistique et le milieu de vie afin qu’ils cohabitent.
Je poursuis ma marche. Au détour d’une artère, je rencontre à nouveau une photographie perchée sur une tige d’acier. Plantée dans un gazon vert, elle borde un mur de pierres grises qui découpent un ciel bleu. Je réfléchis. Ma mémoire me joue un tour. Les temporalités se sont mélangées. Maintenant je me souviens, le gazon vert réside dans la photo. Le sol est plutôt recouvert de neige. Ce jour-là, le ciel gris pâle, le mur gris foncé et le sol blanc suggèrent davantage une photo noir et blanc. Ainsi, lors de mon passage, cette photographie couleur s’inscrit dans un environnement noir et blanc et renvoie à la journée ensoleillée et chaude de sa prise de vue. Fragment du mur qu’elle représente, elle projette la matérialité de cette pierre et l’âge de ce mur servant de fortification dont la construction a débuté dès 1608.
Ainsi, Arzapalo élabore un dispositif qui révèle une temporalité de l’errance dans une sédimentation de couches de temps. Cette accumulation se trouve concrètement dans la présentation de la photographie sur le site de sa prise de vue et virtuellement dans le trajet où nous construisons l’image. L’errance dans la ville inscrit la photographie dans une durée qui donne à l’image la possibilité de se construire dans le temps. Ce rapport intime avec les emplacements au cœur de la ville et les morceaux d’architecture révèle une histoire. Le passé collectif rejoint le présent individuel de l’expérience. L’image se façonne à partir d’une trame de souvenirs personnels et collectifs. L’errance dans la cité devient le lieu de l’événement qui expose l’architecture de l’image et permet au visiteur de l’habiter pour rencontrer son temps. Là, il y a accès à la structure métaphorique de l’image.
À la fin de la pérégrination proposée par l’artiste, je me trouve dans une chambre blanche, dans un espace vide où tout peut se produire. En quelque sorte, l’aire devient une métaphore de mon expérience face à l’œuvre et de mon intériorité. Peu d’éléments composent l’espace: des volumes aux murs blancs et aux planchers en contreplaqué, une poutre et une colonne de bois. Il n’y a rien et tout est là. Je prends conscience de moi-même dans ce lieu, de ma verticalité par rapport aux axes, de la transformation de la spatialité en relation avec mon déplacement. Puis, j’aperçois une photographie accrochée à un mur de la salle d’exposition. Elle redouble le lieu et accentue la conscience de mon positionnement dans cet espace. La chambre est vide dans la photo mais se remplit de présence lorsque je me tiens devant mon absence. Maintenant, j’habite ce lieu qui m’offre une sensation de temps et je deviens la différence.
L’œuvre d’Alfonso Arzapalo nous met face à notre durée.
Le temps nous entoure de toute part.
- Rossi, Aldo. 1990, L’Architecture de la ville. Traduction de Françoise Brun, Paris: Éditions Livre & communication. p. 7.